
Dans un monde dominé par les systèmes de positionnement global (GPS, GNSS), il peut sembler anachronique de s’intéresser à une méthode ancienne comme la navigation à l’estime – ou dead reckoning. Pourtant, cette technique, fondée sur le calcul de position en intégrant cap, vitesse et temps depuis une position connue connaît aujourd’hui une véritable résurgence. Portée par les progrès des capteurs inertiels (IMU), des Doppler Velocity Logs (DVL), et des algorithmes de fusion de données embarqués, elle devient un socle indispensable dans les environnements où les signaux GPS sont inaccessibles, instables ou perturbés.
Les véhicules sous-marins téléopérés (ROVs), notamment les unités compactes développées par Deep Trekker, illustrent cette réinvention. Grâce à une combinaison astucieuse de capteurs embarqués et de logiciels propriétaires comme BRIDGE, ces systèmes peuvent naviguer, inspecter et opérer dans des contextes hautement contraints — sans dépendre d’un repère externe.
À travers cette analyse, nous verrons comment une méthode ancienne redevient centrale dans les logiques modernes de navigation autonome, industrielle et robotisée.
De la navigation maritime à l’innovation sous-marine
Origines et évolution du « dead reckoning »
La navigation à l’estime est l’un des plus anciens procédés de localisation utilisés par les marins. Bien avant l’avènement du GPS, elle permettait de déterminer une position approximative à partir d’un point connu, en intégrant les données de cap, vitesse et temps de déplacement. Ce calcul cumulatif, bien que pratique, s’avérait vulnérable à la moindre erreur de mesure : vents, courants marins ou dérives instrumentales pouvaient compromettre la précision. Malgré ses limites, cette technique a longtemps été centrale dans la navigation aérienne, maritime et terrestre.
Avec la généralisation des systèmes satellitaires, le « dead reckoning » fut relégué au rang de méthode d’appoint ou de secours. Cependant, dans des environnements où le signal satellite est bloqué ou inexploitable — comme sous l’eau, ou dans certaines zones militaires — cette méthode a regagné de l’intérêt stratégique.
Son retour dans les technologies modernes en environnements extrêmes
Aujourd’hui, grâce aux avancées en robotique, en capteurs MEMS et en calcul embarqué, la navigation à l’estime est redéployée sous une forme nouvelle. Dans l’univers des véhicules sous-marins téléopérés (ROVs), notamment ceux de Deep Trekker, elle devient une méthode de référence pour assurer une navigation fiable sans GPS.
Les environnements subaquatiques, par définition inaccessibles aux signaux satellites, imposent des contraintes extrêmes : visibilité nulle, turbulences, obstacles, interférences électromagnétiques. Les ROVs doivent donc disposer d’une navigation autonome, robuste et temps réel. C’est dans ce contexte que le « dead reckoning » s’impose.
Principes fondamentaux de la navigation à l’estime
Estimation de position sans GPS : fonctionnement interne
Le cœur de la navigation à l’estime repose sur une logique incrémentale : à partir d’une position initiale connue, la trajectoire d’un véhicule est estimée en cumulant les variations de direction (cap) et de déplacement (vitesse) sur un temps donné. Cette approche repose donc sur l’intégration de données dynamiques, mesurées en temps réel par une série de capteurs embarqués.
Dans le cas des ROVs Deep Trekker, cette position initiale est généralement définie lorsque l’appareil est mis à l’eau, en surface, parfois via GPS. À partir de ce « point zéro », la position du véhicule est recalculée en continu à mesure qu’il se déplace. La précision de cette méthode est directement liée à la qualité et à la calibration des capteurs utilisés.
Mais cette approche est fondamentalement sensible à la dérive : toute erreur de mesure, même minime, tend à s’accumuler au fil du temps, générant une perte de précision croissante. D’où la nécessité, comme le recommande Deep Trekker, de réinitialiser la position du système à intervalle régulier – typiquement toutes les heures – pour éviter des écarts trop importants.
Le rôle des IMU, DVL et algorithmes d’intégration
Le système Deep Trekker repose sur une architecture capteur-software avancée pour fiabiliser cette navigation à l’estime. Trois composants clés entrent en jeu :
IMU (Inertial Measurement Unit) : Capteur central qui mesure l’accélération linéaire, la vitesse angulaire et parfois l’orientation. C’est l’élément principal pour estimer les changements de position à court terme, mais il est sujet à une dérive significative sans correction externe.
DVL (Doppler Velocity Log) : Il mesure la vitesse relative par rapport au fond marin à l’aide d’effets Doppler. Plus précis que l’IMU pour estimer les déplacements réels, surtout dans un environnement aquatique où les repères sont absents.
Algorithmes de fusion de données : Ces algorithmes, embarqués dans le contrôleur BRIDGE, permettent de combiner les données issues de l’IMU, du DVL et d’autres capteurs éventuels (compas, pression, profondeur) pour produire une estimation plus fiable et cohérente de la position. Cette « sensor fusion » réduit les erreurs liées à chaque capteur pris isolément et augmente la robustesse du système.
L’intégration efficace de ces capteurs permet aux mini-ROVs Deep Trekker de fonctionner avec une précision acceptable, même dans des environnements complexes comme les coques de navires, les canalisations ou les fonds portuaires.
Les ROVs et l’autonomie opérationnelle : un cas d’usage professionnel
Intégration sur les mini-ROVs Deep Trekker : architecture système
L’approche de Deep Trekker en matière de navigation à l’estime repose sur une intégration matérielle et logicielle complète, pensée pour les contraintes extrêmes du milieu sous-marin. Deux modèles de ROVs sont principalement concernés : le PIVOT (v3.0+) et le REVOLUTION (v6.9+), tous deux compatibles avec le Sensor Pod+ et le DVL de la marque.

La base du système est le BRIDGE Controller, une interface de contrôle robuste dotée de fonctionnalités de calcul embarqué avancé. À partir d’une position initiale (souvent GPS, en surface), le système active le mode dead reckoning, prenant en compte les données de l’IMU et du DVL pour estimer en temps réel la position sous l’eau.
La configuration nécessite :
- Un calibrage initial du cap et de la vitesse via les capteurs embarqués.
- L’activation d’un mode de suivi de trajectoire dans le contrôleur BRIDGE.
- Une surveillance continue de la dérive, corrigée soit par des réinitialisations manuelles, soit par des points de repère connus en environnement contrôlé.
Cette architecture permet aux opérateurs de bénéficier d’une interface conviviale tout en exploitant des capacités de navigation avancées, avec un minimum d’infrastructure externe. L’ensemble est optimisé pour les missions rapides, répétitives ou complexes, dans des contextes où la détection GPS est impossible.
Cas d’usage : inspection navale, maintenance d’infrastructures, missions critiques
La mise en œuvre de la navigation à l’estime avec ROVs Deep Trekker ouvre la voie à une automatisation efficace de nombreuses tâches professionnelles en milieux contraints.
· 1. Inspection de coques de navires
Dans les ports ou en zone de mouillage, la navigation à l’estime permet aux mini‑ROVs d’explorer les flancs et fonds de navires sans qu’il soit nécessaire de les échouer ou d’engager des plongeurs humains. Cela représente un gain considérable en termes de sécurité, de temps et de coûts opérationnels.
· 2. Surveillance d’infrastructures subaquatiques
Les pipelines, câbles sous-marins et structures de plateformes offshore peuvent être inspectés avec une précision renforcée, même en l’absence de signal GPS. La navigation à l’estime garantit une continuité de localisation sur des parcours linéaires, souvent critiques dans ces contextes.
· 3. Recherche et sauvetage (SAR)
Dans des contextes d’urgence, comme le repérage d’un objet submergé ou la recherche d’une personne, les ROVs utilisant le dead reckoning peuvent rapidement intervenir dans des zones à faible visibilité, cartographier les zones couvertes et optimiser les chances de succès.
· 4. Archéologie sous-marine et recherche scientifique
Les équipes scientifiques bénéficient d’un système de navigation fiable, essentiel à la documentation précise des lieux étudiés (sites archéologiques, habitats marins), sans recours à des balises ou GPS acoustiques.
À travers ces cas d’usage, la navigation à l’estime devient un véritable catalyseur d’autonomie fonctionnelle pour les ROVs dans des contextes professionnels exigeants.
Défis techniques et limites de la navigation à l’estime
Dérive, erreurs cumulées, turbulences : sources d’imprécision
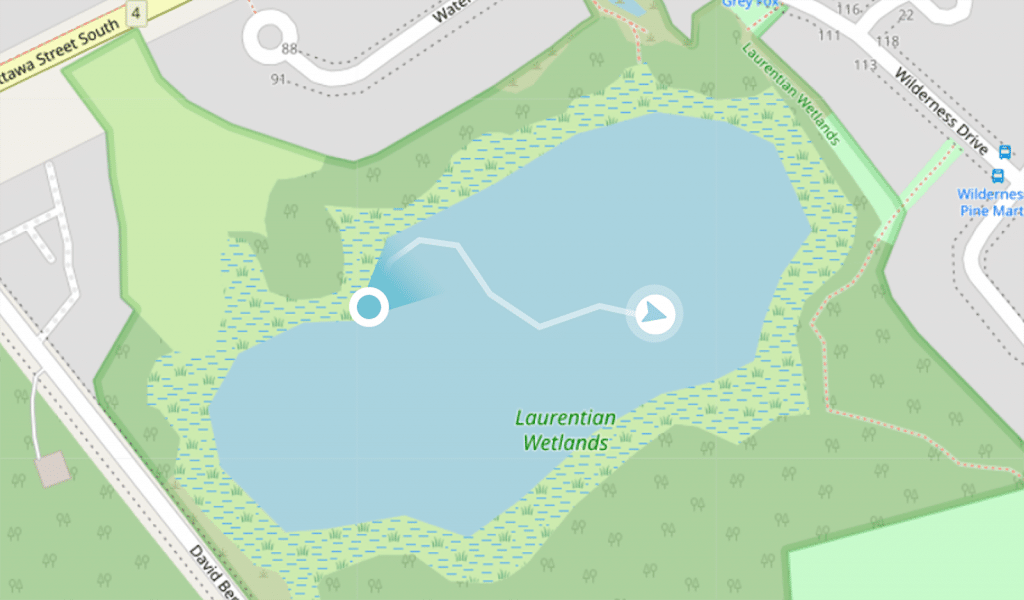
Malgré ses atouts en environnement dégradé, la navigation à l’estime reste soumise à plusieurs limites structurelles. La principale faiblesse tient à la dérive cumulative : puisque la position est estimée par intégration successive de petites variations, toute erreur – même marginale – tend à s’amplifier au fil du temps.
Cette accumulation peut résulter :
- D’un biais capteur (IMU mal calibrée, dérive gyroscopique),
- D’interférences électromagnétiques perturbant les capteurs de direction,
- D’un environnement dynamique (courants, turbulences) introduisant un écart entre le mouvement réel et estimé,
- D’un bruit de mesure amplifié dans les zones complexes comme les ports, épaves ou structures métalliques.
Ces facteurs rendent l’usage du dead reckoning sur de longues durées ou distances délicat sans correction régulière. Deep Trekker recommande explicitement de réinitialiser le point de départ toutes les heures pour limiter la perte de précision.
Solutions innovantes : fusion de capteurs, calibrations adaptatives, algorithmes hybrides
Face à ces limites, les innovations logicielles et matérielles mises en œuvre par Deep Trekker visent à renforcer la fiabilité et la stabilité du système. Plusieurs approches combinées sont utilisées :
- Fusion de capteurs (Sensor Fusion) : Grâce à l’algorithme embarqué dans le contrôleur BRIDGE, les données issues de l’IMU, du DVL et d’autres modules (compas magnétique, capteur de profondeur) sont combinées de manière pondérée. Cela permet de réduire l’impact de chaque erreur individuelle, tout en tirant parti des forces complémentaires des différents capteurs.
- Calibrations adaptatives : Les procédures de mise à zéro initiale, recommandées à chaque immersion, garantissent une cohérence des mesures de cap et de vitesse. Des recalibrations périodiques manuelles ou déclenchées par seuils de dérive assurent un maintien de précision opérationnelle.
- Algorithmes hybrides et corrections contextuelles : Le système BRIDGE autorise une logique de mise à jour de position à partir de points de repère connus (par exemple : retour à un point fixe en surface, contact avec un mur identifié, etc.). Cela permet de « corriger » la trajectoire estimée en injectant ponctuellement des références absolues, même dans un environnement sans GPS.
Ces solutions renforcent considérablement la robustesse du système, et permettent d’utiliser la navigation à l’estime de manière fiable dans des contextes autrefois jugés trop imprévisibles pour une estimation purement inertielle.
Vers un futur autonome : prospective et applications industrielles
Développement R&D en cours (ROVs, AUVs, drones hybrides)
La relance de la navigation à l’estime par les industriels de la robotique sous-marine, dont Deep Trekker, s’inscrit dans un mouvement plus large d’automatisation de la navigation autonome. Le dead reckoning devient une brique technologique centrale dans la conception de ROVs plus intelligents, mais aussi dans celle de véhicules autonomes sous-marins (AUVs) ou hybrides.
Les efforts R&D se concentrent notamment sur :
- L’amélioration des capteurs inertiels, plus précis, plus résistants au bruit.
- L’intégration de DVLs miniaturisés, rendant la navigation inertielle accessible aux plateformes de plus en plus petites.
- Le développement d’algorithmes de correction dynamique, capables d’identifier en temps réel les dérives et de les compenser automatiquement.
- L’ajout d’intelligences embarquées qui pourraient intégrer des systèmes de perception (vision, sonar) pour recouper les données estimées avec des indices environnementaux.
Deep Trekker propose déjà une préfiguration de ces approches avec ses unités compactes équipées de capteurs multiples et d’une interface simplifiée, permettant à des opérateurs non-experts de bénéficier de la puissance d’un système de navigation autonome.
Intégration dans des stratégies industrielles globales (énergie, défense, recherche)
Le dead reckoning, longtemps outil de navigation de secours, s’impose désormais comme un élément stratégique dans les secteurs industriels où la navigation sans GPS est critique :
- Énergie offshore : L’inspection automatisée des plateformes pétrolières, éoliennes ou gazières nécessite une navigation fine et autonome. Le dead reckoning permet des opérations régulières sans infrastructure fixe (balises, câbles).
- Défense et sécurité maritime : Dans les zones sensibles, l’absence de dépendance au GPS devient un avantage tactique. La navigation à l’estime embarquée sur des drones ou ROVs permet des missions discrètes, autonomes et fiables.
- Recherche et environnement : Cartographier les habitats sous-marins, suivre les espèces, ou inspecter les infrastructures écologiques sous-marines impose une couverture cohérente et reproductible, même dans les eaux turbides ou éloignées.
À terme, cette technologie est appelée à jouer un rôle pivot dans les chaînes logistiques automatisées, les systèmes de surveillance environnementale, et les opérations d’urgence à haut risque.
Conclusion : une boussole algorithmique dans un monde sans repères
Loin d’être une simple réminiscence d’une technique ancienne, la navigation à l’estime connaît aujourd’hui une réinvention profonde à la croisée de la robotique, de la perception embarquée et des systèmes autonomes. Dans un monde de plus en plus dépendant de la géolocalisation satellitaire, sa capacité à fonctionner sans repère externe en fait un pilier technologique d’avenir pour les opérations en milieux dégradés.
À travers les solutions développées par Deep Trekker, le dead reckoning devient un levier d’innovation stratégique : il permet de rendre autonomes des systèmes compacts, robustes, adaptables, dans des contextes industriels et scientifiques de plus en plus exigeants. Cette résilience algorithmique, couplée à des capteurs de nouvelle génération et à des interfaces utilisateurs simplifiées, rend accessible une navigation jusqu’ici réservée à des systèmes lourds et coûteux.
Les perspectives ouvertes sont nombreuses. À court terme, on peut envisager :
- Une miniaturisation accrue des plateformes autonomes intégrant la navigation à l’estime.
- L’intégration native de modules de correction adaptative dans les logiciels de mission.
- Une démocratisation de cette approche dans des secteurs hors-marins : mines, égouts, industrie lourde.
- À long terme, la fusion entre dead reckoning, vision computationnelle, IA embarquée et perception contextuelle pourrait faire émerger une nouvelle génération d’agents autonomes capables d’évoluer de manière fiable dans des environnements déstructurés, sans carte ni satellite.
Dans cet avenir algorithmique, la navigation à l’estime n’est plus un outil de secours : elle devient le cœur d’une autonomie opérationnelle maîtrisée.
Nos experts Escadrone sont à votre écoute pour analyser votre besoin et vous proposer une solution matérielle et un accompagnement adaptés.
Contactez nous !
Depuis 2014, Escadrone accompagne ses clients dans l’intégration de la robotique autonome pour des usages civils professionnels.
Pionnière dans la conception, la vente, l’homologation de drones et la formation à ses usages et métiers, elle se positionne comme experte de son domaine et connaît parfaitement tous les acteurs et les produits du marché.
Escadrone vous supporte sur l’ensemble de la chaîne de valeurs depuis la formation à vos outils de collecte d’informations jusqu’au traitement et l’interprétation de vos données.
